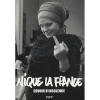LE FIGARO MAGAZINE. - Avez-vous apprécié le film«Des
hommes et des dieux»?
LE FIGARO MAGAZINE. - Avez-vous apprécié le film«Des
hommes et des dieux»?
Frère Jean-Pierre.
- Il m'a très profondément touché. J'ai été ému de revoir les
choses que nous avons vécues ensemble. Mais j'ai surtout
ressenti une sorte de plénitude, aucune tristesse. J'ai trouvé
le film très beau parce que son message est tellement vrai, même
si la réalisation n'est pas toujours exacte par rapport à ce qui
s'est passé. Mais cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est
le message. Et ce film est une icône. Une icône dit beaucoup
plus que ce que l'on voit... C'est un peu comme un chant
grégorien. Quand il est bien composé, l'auteur y a mis un
message, et celui qui le chante trouve plus encore, parce que
l'Esprit travaille en lui. En ce sens, ce film est une icône.
C'est une vraie réussite, un chef-d'œuvre.
Vous n'avez aucune critique à formuler?
J'ai
entendu certains critiquer le rôle du prieur, Christian de
Chergé. Certains le trouvent un peu effacé, mais je le trouve
très bien. D'autres le trouvent austère, car on ne le voit
jamais sourire. Mais il est tout à fait dans le personnage qui
convient à la situation grave que nous avons traversée.
J'admire, dans ce rôle, sa façon d'être à l'écoute des frères,
en particulier dans les moments difficiles. Il ne veut pas
imposer. Il est à l'écoute. On le sent plein de respect pour les
frères. On voit bien le pasteur et son souci de s'ouvrir à Dieu,
pour se laisser travailler par Dieu et avoir la réaction qu'il
faut devant les frères. Dans tout le film, on voit cette
ouverture à Dieu, on l'interroge, on se laisse influencer par
Lui. C'est monastique!
Y a-t-il un manque par rapport à l'histoire
réelle?
Je
n'ai pas ressenti cela.
Mais comment, en tant que moine, vivez-vous le
succès du film?
Nous
sommes comblés et émerveillés de voir un tel succès, mais nous
n'y sommes pour rien! Le fait d'être connu me gêne un peu... Un
moine est fait pour être caché.
Pourquoi étiez-vous opposés au principe du
tournage du film?
Nous
n'avons pas voulu accepter le film et son tournage au Maroc, en
raison du danger d'être soupçonnés de prosélytisme. Certains, à
ce moment-là, ne recevaient plus leur carte de séjour depuis
très longtemps. Nous devions être très prudents mais nous étions
abandonnés à la volonté du Seigneur. Nous n'avons donc pas été
consultés. L'équipe savait notre opposition et les raisons de
notre prudence. Ils ont été très respectueux.
Quand êtes-vous arrivés à Tibhirine?
Je
n'oublierai jamais ce 19 septembre 1964. Quand nous sommes
arrivés en 2 CV près du monastère, je verrai toujours cet
enfant, assis sur un âne, qui vint à notre rencontre pour nous
accueillir. J'étais très heureux. De ma petite cellule, je
voyais la clôture, le jardin et le village au loin. Je me suis
alors dit: voilà le paysage que je verrai jusqu'à la fin de ma
vie. Car dans mon cœur, c'était pour la vie. Sans retour. J'y
suis resté trente-deux ans, de 1964 à l'enlèvement en 1996.
Comment était la vie là-bas?
Les
débuts ont été difficiles. La communauté manquait de stabilité
et ce fut une période très dure à vivre. Par ailleurs, la
nouvelle Algérie se mettait en place. Les relations avec les
gens aux alentours n'étaient pas évidentes. Il y avait des
réflexes de rejet des Français. On ressentait ce fossé à
l'occasion des fêtes, chrétiennes ou musulmanes. On n'avait rien
à voir les uns avec les autres. Nous avons donc lutté contre
cela et essayé de nous apprivoiser mutuellement. Pour cela, le
dispensaire, tenu par le frère Luc, fut très important. Il
recevait jusqu'à 80 personnes par jour! Puis, Christian de
Chergé a été élu prieur, en 1984. Nous avions besoin de
quelqu'un comme lui qui parlait l'arabe et connaissait bien la
culture musulmane. À partir de là, nous sommes devenus une vraie
communauté, plus stable. Ceux qui s'engageaient le faisaient
vraiment. Nous étions quasi indépendants. Ce qui fut un
avantage, car cela nous a permis de prendre beaucoup
d'initiatives dans la relation islamo-chrétienne.
Quel rôle Christian de Chergé a-t-il joué?
Il y a
eu, avec lui, une évolution vers l'islamologie. Il a
personnellement beaucoup étudié le Coran. Le matin, il faisait
sa lectio divina, avec une Bible en arabe. Il faisait
parfois la méditation avec le Coran. Il cherchait à nous faire
évoluer. Nous avions des relations avec l'islam, mais pas à un
niveau intellectuel. Lui connaissait très bien le milieu
musulman et la spiritualité soufie. Certains moines estimaient
que la communauté devait rester équilibrée et que tout ne devait
pas être orienté par l'islam. Ce qui provoqua des frictions. Ces
tensions finirent par être dépassées grâce à la création d'un
groupe d'échange et de partage avec des musulmans soufis, que
nous avions appelé le ribât. Nous avions compris que la
discussion sur les dogmes divisait, car elle était impossible.
On parlait donc du chemin vers Dieu. On priait en silence,
chacun selon sa prière à lui. Ces rencontres bisannuelles ont
été interrompues en 1993, quand cela a commencé à devenir
dangereux. Mais cette connaissance mutuelle a fait de nous de
vrais frères, en profondeur.
En quoi le père Christian de Chergé vous a-t-il
marqué?
Ce qui
m'a frappé chez lui, c'est sa passion intérieure pour la
découverte de l'âme musulmane et pour vivre cette communion avec
eux et avec Dieu, tout en restant vraiment moine et chrétien.
De qui étiez-vous le plus proche?
De
frère Luc! On était très proches tous les deux. Il n'était pas
prêtre, il était frère. On pouvait se confier à lui. Il était
plein de sagesse. Dans une petite communauté où il n'y a pas
beaucoup de prêtres, il n'est pas facile de trouver un directeur
spirituel. Si on avait un problème ou une difficulté de relation
avec un frère, on allait d'abord voir frère Luc, sachant très
bien comment il allait répondre. C'était un modèle... Au
chapitre, même pendant la période de tension et de peur, il
avait toujours le mot pour faire rire. Il était précieux pour la
vie commune. Même si, comme médecin, il avait un régime spécial,
car il était dans son dispensaire toute la journée et qu'il
faisait, en plus, la cuisine! Il commençait ses journées à 1
heure du matin pour être prêt à 7 heures au dispensaire. Il
avait beaucoup d'asthme et n'arrivait pas à dormir. Il dormait
assis! J'étais très proche aussi de frère Amédée, l'autre
rescapé, qui est mort ici, à Midelt.
Priez-vous avec vos frères disparus?
J'essaie d'avoir un temps, tous les matins. On ne les oublie
pas. Ils restent présents. Tous. On essaie de progresser. Le
film, de ce point de vue, nous stimule dans notre vocation.
Vos frères vous parlent dans la prière?
Non,
pas encore... J'ai la certitude qu'ils sont près du Seigneur. Je
l'ai eue dès le début en raison de leur martyre. Cela donne de
la joie, pas de la tristesse. C'est ce que j'éprouve en voyant
le film: de la joie, pas de la nostalgie! (rire). En
espérant que le Seigneur nous envoie d'autres moines qui
voudront vivre cela.
Ne ressentez-vous jamais de nostalgie pour la vie
à Tibhirine?
Un
peu, oui... Nous avons vécu de très belles choses ensemble. Et
puis, cette vie en commun pour représenter le Seigneur et
l'Église. C'est une très belle vocation. Elle peut aller loin.
Le Christ est plus grand que l'Église. Les soufis utilisaient
une image pour parler de notre relation avec les musulmans.
C'est une échelle à double pente. Elle est posée par terre et le
sommet touche le ciel. Nous montons d'un côté, eux montent de
l'autre côté, selon leur méthode. Plus on est proches de Dieu,
plus on est proches les uns et des autres. Et réciproquement,
plus on est proches les uns des autres, plus on est proches de
Dieu. Toute la théologie est là-dedans!
Et pourtant, c'est la mort qui était au
rendez-vous...
Ce que
nous avons vécu là, ensemble et dès le début, était une action
de grâce. On s'était préparés ensemble. Par fidélité à notre
vocation, on avait choisi de rester en sachant très bien ce qui
pouvait arriver. Le Seigneur nous envoie, on ne va pas
démissionner même si, autour de nous, les violents cherchent à
nous faire partir, et même les officiels. Mais nous avons Notre
Maître et nous étions engagés par rapport à Lui. En second lieu
est venue la volonté d'être fidèles aux gens de notre
environnement pour ne pas les abandonner. Ils étaient aussi
menacés que nous. Ils étaient pris entre deux feux, entre
l'armée et les terroristes, les maquisards. La décision de ne
pas se séparer avait été prise en 1993. Et même si nous avions
été dispersés par la force, on devait se retrouver à Fès, au
Maroc, pour repartir s'établir dans un autre pays musulman.
Comment vivez-vous ce qui s'est passé: comme un
échec ou comme un accomplissement?
Après
l'enlèvement, le père Amédée et moi avons été obligés de
descendre à Alger avec la police. On priait pour nos frères.
Pour que Dieu leur donne la force et la grâce d'aller jusqu'au
bout. On attendait une intervention de la France ou une
intervention ecclésiastique qui obtienne leur libération. On a
appris leur mort le 21 mai 1996. Nous étions en train de prier
les vêpres. Soudain, un jeune frère est arrivé à la chapelle et
s'est jeté devant tout le monde à plat ventre, criant son
désespoir: «Les frères ont été tués!» Le soir, alors que nous
étions côte-à-côte à faire la vaisselle, je lui ai dit: «Il faut
vivre cela comme quelque chose de très beau, de très grand. Il
faut en être digne. Et la messe que nous dirons pour eux ne sera
pas en noir. Elle sera en rouge.» Nous les avons tout de suite
vus, en effet, comme des martyrs. Le martyre était
l'accomplissement de tout ce que nous avions préparé depuis
longtemps, dans notre vie. Ces années que nous avions vécues
ensemble dans le danger. Nous étions prêts, tous. Mais cela n'a
pas exclu la peur.
Quand la peur a-t-elle commencé?
À
partir de 1993, lors de la visite du GIA, le soir de Noël. La
communauté s'est alors beaucoup développée en union et en
profondeur. Le danger était désormais partout, de tous les
instants, nuit et jour. Cela nous a beaucoup secoués. On est
vraiment passés par le creux à ce moment-là.
Que s'est-il passé exactement?
Noël
1993, le soir, ils ont fait le mur. On était dans la sacristie
avec Célestin, qui préparait les fiches de chants pour la messe
de Noël. Des hommes armés jusqu'aux dents nous ont encerclés.
Les Croates venaient d'être tués, on pensait y passer aussi. Ils
nous ont rassurés. Parce que nous étions des religieux, ils ne
nous feraient rien. Mais ils ont alors commencé à taper sur le
gouvernement. Puis le chef a dit: «Je veux voir le pape du
coin.» On est allés chercher Christian, qui a tout de suite dit:
«Non, on n'entre pas ici avec des armes. Si vous voulez venir
ici, laissez vos armes à l'extérieur. Personne n'est jamais
entré ici avec des armes. Ici, c'est une maison de paix!» Ils
ont finalement discuté et ont demandé trois choses: que le
docteur puisse venir soigner les blessés dans la montagne, des
médicaments, de l'argent. Avec tact, Christian a répondu non aux
trois demandes. Sauf pour les blessés, qui pouvaient venir,
comme tout le monde, au dispensaire. Puis il a dit en arabe que
nous préparions «la fête de la naissance du prince de la paix».
Ils ne le savaient pas et se sont excusés, mais ils ont dit: «On
reviendra.» En donnant un mot de passe: ils demanderaient
«monsieur Christian». Ce soir-là, la messe de minuit a eu un
goût particulier. Le lendemain, au chapitre, nous avons commencé
les discussions sur l'avenir.
Qu'avez-vous alors décidé?
Que
s'ils demandaient de l'argent, on leur en donnerait un peu pour
éviter la violence, mais nous pensions toutefois partir, car
nous ne voulions pas collaborer avec eux. Puis l'évêque d'Alger
est venu nous dire que si l'on décidait de quitter, il ne
fallait pas quitter tous ensemble, pour ne pas affoler l'Église
d'Algérie. On a décidé que deux d'entre nous partiraient.
Célestin, qui avait été traumatisé par ce Noël et qui devait
subir six pontages cardiaques, et frère Paul, qui avait besoin
de repos.
Y avait-il unanimité entre vous?
Il y a
eu un autre chapitre après ce Noël. Les uns pensaient qu'il
fallait rester, les autres qu'il valait mieux partir. D'autant
qu'à ce moment-là, par sécurité, nous avons été obligés de
fermer le monastère dès la fin de l'après-midi et jusqu'au
matin. Nous avons aussi dit aux retraitants de ne plus venir.
Nous étions isolés. Cela a changé l'économie du monastère et il
fallait trouver d'autres moyens pour vivre.
Il y a donc eu des divergences?
Ça a
évolué. Le père Armand Veilleux, venu prêcher une des dernières
retraites, nous avait dit que nous étions arrivés «au sommet» de
notre vie commune. Nous étions en effet parvenus à l'unanimité à
la décision de rester. Les relations fraternelles s'étaient
encore soudées. En chapitre, nous ne pouvions prendre à la
légère des décisions aussi graves. Par rapport au GIA, par
rapport à un départ, sur notre conduite si nous étions enlevés
ou dispersés... Nous étions alors tous décidés à rester, mais la
peur de ce qui allait arriver était présente, plus ou moins,
chez les uns et les autres. Mais il fallait continuer à vivre.
Il y avait des attentats à droite et à gauche. Des proches du
monastère avaient été arrêtés ou menacés. Voilà le climat dans
lequel on vivait.
Pas de sérénité, même une fois posé le choix de
rester?
Non,
aucune. Le soir, quand on chantait complies, il y avait comme
une chape de danger, de plomb, qui planait sur le monastère. De
nuit, il pouvait arriver n'importe quoi. On se disait: que
va-t-il se passer cette nuit? On n'envisageait pas d'être tués,
mais on savait que cela pouvait arriver à n'importe quel moment.
On avait la chance d'être une communauté. Et la vie continuait,
l'un était cuisinier, l'autre jardinier, l'autre s'occupait de
l'administration. Cela permettait d'oublier, mais le soir, la
nuit, on se demandait ce qui pouvait arriver. On ne se le disait
pas, mais chacun y pensait.
Et que s'est-il passé le soir de l'enlèvement?
Le
soir de l'enlèvement, j'étais dans la pièce du portier. Je me
suis réveillé vers 1 heure, aux bruits de voix devant le
portail. Ils étaient déjà à l'intérieur, dans le jardin. Sans
doute voulaient-ils voir le docteur. J'attendais qu'ils frappent
à la porte pour me manifester. Je suis allé voir à la fenêtre.
J'en ai vu un qui allait directement vers la chambre de frère
Luc. Ce qui n'était pas normal, car quand on veut voir le
docteur, on frappe au portail et le portier se présente. Et j'ai
entendu une voix qui disait: «Qui est le chef?». Et j'ai reconnu
Christian. Je me suis dit: «Il les a entendus avant moi, il leur
a ouvert et va leur donner ce qu'ils veulent.» Au bout d'un
quart d'heure, j'ai entendu la porte qui donne sur la rue se
fermer et j'ai pensé qu'ils étaient partis. Un peu plus tard, le
père Amédée a frappé et m'a dit: «Les frères ont été enlevés!»
Ils étaient donc sortis par derrière, sinon je les aurais
entendus.
Qu'avez-vous ressenti alors?
La
question que je me suis immédiatement posée était de savoir: si
je les avais entendus et vus sortir, qu'aurais-je fait?
Serais-je resté ou aurais-je couru derrière pour aller avec eux?
Et votre réponse?
Je
n'ai pas encore répondu. Si cela s'était passé, cela n'aurait
pas été facile, mais j'ai le sentiment que j'aurais couru
derrière. Amédée m'a dit aussitôt: «Ils ne vont pas les tuer,
car s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait tout de
suite.» Il était en effet très difficile de circuler dans la
montagne la nuit, car il y avait un poste militaire pas loin,
sur la colline. De plus, frère Luc avait 82 ans et un autre
venait de sortir de l'hôpital, avec six pontages. Marcher avec
des gens comme cela, ce n'était pas facile. On pensait qu'ils
allaient se servir d'eux pour quelque chose. En attendant, nous
nous sentions tout seuls, privés de nos frères. La communauté
était démolie. Nous espérions bien qu'ils seraient vite libérés,
car s'ils ne revenaient pas, la vie était finie au monastère.
Pourquoi les ravisseurs ne sont-ils pas passés
comme d'habitude?
Quand
ils venaient, ils faisaient le mur. Puis, de l'intérieur,
ouvraient la porte qui donnait sur la rue. Il y avait une simple
targette. Cette porte n'était jamais fermée à clé. Nous voulions
que nos relations soient fondées sur la confiance mutuelle.
Les ravisseurs étaient des gens du GIA ou non?
Le
gardien du monastère m'a dit qu'ils étaient venus d'abord chez
lui en disant qu'ils voulaient voir le docteur, sous prétexte
qu'ils avaient deux blessés graves. Il leur avait répondu que
les pères lui avaient interdit de prolonger son service de garde
du monastère pendant la nuit. Ce qui était vrai, nous le lui
avions interdit afin qu'il n'y ait pas de problème pour sa
famille et pour lui en cas de malheur, s'il survenait une
agression... Ils ont insisté. Le gardien est alors sorti de chez
lui par la cour intérieure pour se rendre au monastère. Là, il
est tombé sur un groupe qui était déjà dans la cour. Emmené
devant le portail qui donnait chez le portier, il se trouvait au
milieu d'un autre groupe qui avait déjà arrêté le père
Christian. Ce dernier posa alors la question: «Qui est le chef?»
L'un des ravisseurs répondit en désignant le meneur: «C'est lui,
le chef, il faut lui obéir.» Puis l'un d'eux, s'adressant au
gardien, demanda: «Ils sont bien sept?» Le gardien a répondu:
«C'est comme tu dis.» Or, nous étions neuf... C'est donc
probablement la raison pour laquelle père Amédée et moi-même
n'avons pas été emmenés; car lorsqu'ils eurent arrêté sept
frères, ils ont quitté les lieux sans fouiller la maison.
Mais vous, que pensez-vous: qui les a enlevés? Le
GIA ou l'armée?
Nous
ne savons que ce qui est arrivé au monastère. Pour le reste, on
se pose des questions comme tout le monde. L'enquête continue.
Pour ce qui est du GIA, le gardien m'a raconté que quand ils
sont redescendus, l'un de ceux qui l'accompagnaient a dit à l'un
de ses collègues: «Va chercher une ficelle, il va voir ce que
c'est que le GIA», car ils voulaient l'égorger, mais il a réussi
à s'éclipser.
Plusieurs années plus tard, vous n'y voyez pas
plus clair sur les motifs de l'enlèvement?
On n'y
voit pas clair. Dans un de ses communiqués sur la radio Medi 1,
le GIA donne une raison à leur mise à mort: «Les gens
s'évangélisent à leur contact, car ils avaient des relations et
ils sortaient de leur monastère, ce que des moines ne doivent
pas faire. Ils méritent la mort. Nous sommes en droit de les
exécuter.» Voilà donc une des raisons. Elle est donnée par les
islamistes eux-mêmes. Par la suite, d'autres motifs ont été
donnés qui sont plutôt des hypothèses, en attendant le verdict
du juge d'instruction, qui poursuit une enquête sur les
circonstances de leur enlèvement et de leur mise à mort.
Comment vivez-vous cette énigme?
On
aimerait bien savoir qui les a tués et où les corps sont
enterrés. On aimerait bien le savoir, mais c'est tout, cela ne
m'inquiète pas plus. Cela ne change rien à la mort des frères.
Ils sont morts pour les raisons pour lesquelles ils avaient
choisi de rester. C'est pour cela que ce sont des martyrs. Ils
ont donné leur vie. Ils étaient prêts à donner leur vie pour
cela.
Peut-on espérer le martyre?
Certains l'ont fait, mais ce n'était pas notre état d'esprit. On
ne le souhaitait pas, on n'était pas là pour cela. Mais il
fallait être prêt à cela. Nous étions dans les mains de Dieu. Et
c'est pour cela que, vivant dans cet état d'esprit, mes frères
sont morts. Je dois reconnaître et dire que nous n'avons pas été
extrêmement choqués. Bien sûr, cela marque, cela fait souffrir,
cela fait de la peine... Mais on savait «pourquoi», on était
tous prêts pour cela! La vie n'est qu'un passage, elle se
termine d'une façon ou d'une autre. Après, on rejoint le
Seigneur.
Le film de Xavier Beauvois, inspiré de leur
sacrifice, peut-il être un ferment de réconciliation entre
chrétiens et musulmans?
Bien
sûr! L'exemple des frères, dans leur relation avec les gens,
avec les musulmans, montre que l'on peut devenir de vrais
frères, dans la communion, ensemble, en profondeur et pas
seulement en surface. En profondeur, devant Dieu. Certains l'ont
vécu. Ce n'est pas rare. Quand les chrétiens voient cela, ils se
rendent compte que les musulmans sont des gens comme les autres.
Certains sont très bons: les valeurs d'accueil, de gentillesse,
de serviabilité, se voient. Ainsi que les valeurs d'union à
Dieu, de prières quotidiennes. Ils ont des relations avec Dieu
qui sont parfois très surprenantes et qui sont de véritables
exemples pour nous, chrétiens. Un ami de Christian, qui a donné
sa vie pour lui, lui disait: les chrétiens ne savent pas
prier... Ils sont très charitables, ils rendent beaucoup de
services, mais on ne les voit jamais prier! Beaucoup de
chrétiens pourraient entendre cela.
Vous n'avez jamais ressenti de haine pendant et
après un tel drame?
C'est
curieux, mais je n'éprouve pas ce sentiment-là.
Et d'amertume?
Non
plus.
Comment interprétez-vous le durcissement actuel
de certains musulmans contre les chrétiens, dont les attentats
récents ont été un signe?
Cela
vient des extrémistes. Les vrais musulmans disent, ce n'est pas
nous cela. Ils ont honte de ce qui est arrivé aux frères. Cela
n'est pas la « religion ». D'autre part, on ne se connaît pas
assez. On se perçoit à travers les violents et cela crée une
tendance à se regrouper entre soi et une peur des contacts. La
solution, c'est de cultiver l'amitié, même si on peut se faire
rouler.
Se faire rouler?
Oui,
certains disent, la réciproque, on ne la voit pas ou peu: on
permet aux musulmans de construire des mosquées chez nous, mais
on peut toujours courir pour construire des églises chez eux!
Vous le pensez vraiment? Les chrétiens sont, de
fait, souvent accusés de naïveté avec l'islam...
La
question n'est pas là. Par la foi, nous risquons! C'est dans
l'Évangile: «Aimez comme je vous ai aimés.» Alors, on est
souvent perdant, il faut le savoir. Mais il arrive que cela
réagisse. Alors, la réciprocité est là et une reconnaissance
mutuelle peut aller très loin.
Quelle est votre espérance pour 2011?
Il
faut espérer que l'amour soit toujours le plus fort. Que l'amour
de Dieu aura le dernier mot. Fondée en Dieu, l'espérance doit
demeurer. Et ce n'est pas nous qui pouvons résoudre cela.
L'espérance invin cible, comme disait Christian de Chergé. Elle
ne doit pas être vaincue, elle doit toujours rester ouverte,
fondée sur Dieu, sur Sa grâce. Même quand on meurt sous les
coups. Comme il disait, l'espérance doit rester ouverte...
LIRE AUSSI :
» REPORTAGE - Retour à Notre-Dame de l'Atlas
» Ils se battent pour rester chrétiens
» MON FIGARO SELECT - Des hommes
et des dieux, les raisons d'un succès